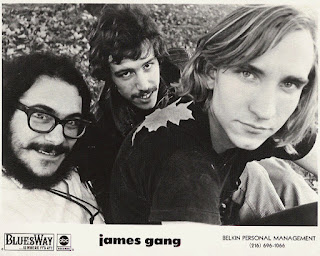"Mais
ce qui rend aussi ce disque si exceptionnel, c’est la pureté et la
densité de l’agression sonore."
SAVAGE :
Loose’N’Lethal
1983
Je
n’ai jamais réussi à poser des mots sur ce disque à la hauteur
de mon appréciation. Je suis incapable de dire fondamentalement
pourquoi. Je me sens tétanisé, pris à la gorge. Pourtant, je
devrais en avoir, des choses à raconter. D’abord, évoquer combien
il m’éblouit lorsque je l’écoutai la première fois, et
combien il rayonne encore plus de vingt ans après sa découverte.
Mais parler
justement de ce bijou d’électricité incandescente m’est
irrémédiablement difficile. Sans doute aussi parce qu’il reste
une sorte de mystère à mes yeux, étant toujours dans
l’impossibilité de trouver à ce jour la véritable raison qui fit
jaillir ce disque.
L’histoire
de Savage est d’un grand classicisme. Mansfield, petite bourgade du
Nord de l’Angleterre, entre Sheffield et Nottingham. Chris Bradley
est un jeune fan de Hard-Rock et de Heavy-Metal. La chose est assez
rare dans la ville en 1977. Les gamins écoutent du Disco, de la
variété, mais le Rock ne fait plus trop la une des radios
anglaises. On parle bien de ce nouveau mouvement appelé Punk, mais
il concerne surtout Londres. Quand on écoute du Rock dans les villes
industrielles de Grande-Bretagne comme Sheffield, on reste ancré du
côté du Hard-Rock. Bradley va donc se fournir en Thin Lizzy, UFO,
Judas Priest et autre Black Sabbath dans la ville de l’acier. Il
décide rapidement de fonder un groupe, et démarche un type plutôt
doué qu’il a repéré pour tenir la guitare. A force d’insister,
il finit par sympathiser avec le frère de ce dernier, un certain
Andy Dawson, lui aussi guitariste. Les deux gamins entraînent avec
eux un autre six-cordiste du nom de Wayne Renshaw, et le batteur Dave
Lindley.
Quelques
démos sont mises en boîte, mais il faut attendre 1981 pour
qu’enfin, le quartet nommé Savage grave officiellement ses
premiers morceaux sur vinyle. Ce sont deux premières moutures de
« Let It Loose » et « Dirty Money » qui font
leur apparition sur une compilation de formations de Heavy-Metal
locales :
Scene Of The Crime,
produit par un obscur label du nom de Suspect Records. Ce dernier est
celui du manager d’un des groupes apparaissant sur le disque :
Sparta. Savage n’aura aucun mal à faire la différence vis-à-vis
de ses camarades de 33 tours de par leur niveau musical largement
supérieur. Pour en faire partie, ils durent mettre la main à la
poche, et y furent inclus à la dernière minute, enregistrant leurs
morceaux avec le couteau entre les dents. Le disque est auto-financé
par les groupes qui y apparaissent, bénéficiant en tout et pour
tout de deux jours de studio. Chacun repart avec cent copies du 33
tours pour le vendre lui-même. Au moment du pressage, la maison de
disques est persuadée que Chris Bradley et Andy Dawson sont frères,
et leur donne donc le même nom, Bradley, sur la pochette. Cela
obligera ainsi le guitariste à découper de petits papiers avec son
vrai nom, et les coller sur le
verso des albums avant de les vendre. Le début de la légende
commence également avec ce disque : c’est grâce à lui que
Lars Ulrich, futur
batteur
de Metallica, découvre Savage. Son groupe reprendra « Let It
Loose » et « Dirty Money » pour une démo en 1982,
et les deux morceaux apparaîtront à plusieurs reprises sur les
set-lists du groupe de Thrash de San Francisco. Malheureusement, et
contrairement à d’autres formations de la New Wave Of British
Heavy-Metal dont Ulrich était friand, comme Diamond Head, Metallica
n’enregistrera pas ces morceaux pour leurs
disques de reprises Garage
Inc.,
vendu
à plus de cinq millions d’exemplaires en 1998.
Savage n’aura donc pas le plaisir de bénéficier d’un chèque de
royalties confortable, et ce alors que leur musique aura servi de
matériau essentiel à celle de Metallica.
Ces
deux morceaux, d’une pureté électrique totale, vont en tout cas
faire suffisamment de bruit pour attirer un autre label, plus
conséquent au niveau national : Ebony. Ou plus précisément,
Darryl Johnston, devenu manager de Savage, et responsable dudit
label. Ce dernier est avec Neat Records l’autre grand pourvoyeur de
Heavy-Metal du début des années 80 en Grande-Bretagne, ce que l’on
appelle la New Wave Of British Heavy-Metal. Si quelques pointures ont
été signés par des majors dès 1980 comme Iron Maiden, Saxon, ou
encore Def Leppard, c’est bien par ces labels indépendants que le
mouvement perdure les années suivantes. Il permet à Savage
d’enregistrer un nouveau morceau, « Ain’t No Fit Place »,
pour une autre compilation des poulains du label, Metal
Fatigue,
en1982. Cette merveilleuse pièce de Heavy-Metal va tant faire
d’étincelles qu’elle convainc Ebony de permettre au quartet de
Mansfield d’enregistrer son premier vrai 45 tours, avec une version
réenregistrée proprement de « Ain’t No Fit Place » et
« The China Run » . Il a aussi sa petite histoire.
L’enregistrement fut auto-financé une nouvelle fois en vue de
publier le disque sur un hypothétique label auto-produit de Savage,
projet qui fut annulé lorsque Johnston arriva providentiellement à
ce moment précis, et leur permit donc de signer avec Ebony, sur
lequel il parut finalement. Le disque fut enregistré durant un
week-end de studio alcoolisé. Dave Lindley joua « Ain’t No
Fit Place » sur un tempo légèrement différent à la version
de la compilation de Metal
Fatigue,
qui
est en fait ultérieure à celle de la session du 45 tours. Les
retours de la presse spécialisée ne sont pas dithyrambiques, voir
même peu enthousiastes, le groupe étant même comparé à un ersatz
de Black Sabbath. Le doute reste entier quant à savoir si c’est la
modification de tempo de Lindley qui en est la cause, ou l’écoute
du simple à la mauvaise vitesse sur l’électrophone du
journaliste.
Affiché
comme une double face A parce que Savage est tout simplement dans
l’incapacité de choisir entre les deux morceaux, il se vend très
convenablement à 1600 exemplaires grâce à la réputation des
concerts du groupe, véritables blitzkriegs électriques d’une
précision infernale. L’un d’eux va devenir mythique avec le
temps, mais là encore, l’histoire et la réalité sont bien
différentes. Savage se produisit en 1982 à l’Hammersmith
Clarendon de Londres, en première partie d’une autre formation
mythique : les danois de Mercyful Fate. La légende veut que nos
héros furent à ce point excellents qu’ils épatèrent
littéralement le chanteur de ces derniers, King Diamond. Bien
évidemment, il en fut tout autre. Savage prêta son kit de batterie
pour une session pour la radio anglaise, en échange de quoi, pour
les remercier, Mercyful Fate les invita à jouer au Clarendon avec
eux. Le manager des danois s’avança même pour leur proposer un
deal : en échange du prêt de tout le matériel des anglais,
ils accompagneraient le Fate sur toute la tournée anglaise, ce qui
n’arriva bien évidemment pas. Il n’y eut au final que ce show en
commun. Andy Dawson ne garda qu’un souvenir très mitigé des
musiciens de Mercyful Fate, pas vraiment sympathiques hormis le
guitariste Hank Shermann. Au final, ce concert n’eut qu’un seul
avantage, néanmoins de taille : obtenir une critique très
positive dans le magazine de Heavy-Metal Kerrang.
Malgré
toutes ces péripéties, le contrat avec Ebony est une opportunité
majeure, car le label a pour objectif de sortir le premier 33 tours
de son histoire en signant Savage. Nous sommes alors en 1983, et les
gars jouent et répètent ensemble depuis cinq ans. Est-ce là la clé
de tout ? Le groupe ne sera pourtant pas satisfait du son de ce
premier album. Ils désiraient celui d’un AC/DC avec Robert Mutt
Lange ou
de
Van Halen avec Ted Templeman, une
prise en direct avec des guitares rugissantes mais
nettes dans le mix.
Cela ne sera pas vraiment le cas. Loose’N’Lethal
est un disque brutal, cru, saturé, violent. Si de nombreux
excellents albums de la NWOBHM ont souffert d’une production
artisanale, ce n’est assurément le cas pour Savage. Certes, s’ils
avaient pu avoir le son dont ils rêvaient…. Mais ce qui rend aussi
ce disque si exceptionnel, c’est la pureté et la densité de
l’agression sonore. Outre le fait que les compositions soient
parfaitement écrites, la musique reste tendue du début à la fin,
sans aucun temps mort. La puissance est telle qu’il subsiste un
grésillement qui fut la critique majeure de l’enregistrement, y
compris de la part des musiciens eux-mêmes. Mais c’est bien cette
qualité de prise en direct sans fioriture qui alimente l’urgence
de la captation. Jeté sur bandes en quelques jours après des années
de concerts et de répétitions assidus, les quatre musiciens,
soudés, propulsent comme un seul homme les huit titres de ce disque.
Et le niveau de violence sonore est monté d’un cran par rapport
aux précédents enregistrements du groupe.
« Let
It Loose » ouvre l’album dans un maelstrom de décibels et un
tempo d’enfer. Certes, le Heavy-Metal n’est guère une nouveauté
en cette année 1983 : Motorhead et Venom sont déjà passés
par là. Pourtant, et en particulier par le son cru, cet hybride de
vitesse et de Heavy-Metal revêche et sale va définir plus que
clairement les contours de ce que sera le Thrash-Metal américain.
Sans doute tellement clairement qu’il n’était pas trop
nécessaire de le rappeler aux fans de Metallica. C’est avec un
enchaînement imparable que résonne « Cry Wolf ». Tempo
bravache, riff mordant, il assomme un peu plus l’auditeur, et
l’écorche d’un solo lumineux et héroïque, parfait successeur
de l’imposant morceau d’ouverture. « Berlin » fait
référence on ne peut plus clair à la Guerre Froide et à la
pesanteur
du climat politique local, et appuie un riff lourd et noir, parfait
descriptif de la violence qui sourde dans le pays. Il n’est en tout
cas pas étonnant que quelques années plus tard surgira de cette
terre le Thrash-Metal le plus agressif de la décennie.
« Dirty
Money » est une relecture d’un ancien morceau déjà paru sur
les multiples compilations auxquelles participa Savage, mais cette
fois-ci avec le son sursaturé lié à cet album, ce qui lui donne un
regain d’agressivité. Le second gros morceau est la dantesque
pièce mid-tempo qu’est « Ain’t No Fit Place ». Il
débute par un introït semi-acoustique
hanté, d’où gronde lentement le larsen électrique. Puis le riff
déchire l’air, et emporte l’auditeur dans un tourbillon de
lyrisme désespéré, cher au meilleur Heavy-Metal. Il n’y a pas
d’endroit où se mettre à l’abri, et c’est tellement vrai. Là
encore, Andy Dawson brille par sa virtuosité à la guitare, offrant
un solo gorgé de rage et de larmes, parfait prolongement émotionnel
au riff central.
« On
The Rocks » est une respiration tapageuse à base de good booze
and bad wimmen, qui annonce les deux derniers temps forts de ce
disque. Le premier est « China Run », cavalcade
ahurissante menée à pleine vitesse comme un train fou. Dawson ne
s’arrête plus de chorusser à l’envi, vrillant le cortex de
l’auditeur pendant que Bradley hurle à la mort comme un loup. Il
s’agit là du Heavy-Metal dans ce qu’il a de plus fulgurant, de
plus trépidant. On retrouve l’excitation de « Whole Lotta
Rosie » d’AC/DC, cette électricité totale, sans retenue,
jusqu’à l’explosion. Le second et ultime temps fort est le
massif « Red Hot », inspiré pour partie du Judas Priest
de la fin des années 70. Son refrain martelé aux toms basses, les
choeurs massifs, le riff teigneux, le solo barbelé, tout est là,
luisant comme la lame d’une épée sous la lune.
Ainsi
se clôt le disque original, complété depuis plusieurs années en
cd par trois démos de 1980 et 1979 totalement impeccables.
On retrouve le son du Savage initial, plus serré, plus rêche, moins
extatique,
mais déjà d’une cohésion totale. « No Cause To Kill »,
le massif « The Devil Take You », et le très Thin
Lizzy-UFO « Back On The Road » (l’enregistrement le
plus ancien), brillent tous de ces qualités intactes malgré un son
brut mais tout à fait audible, vibrant de cette fougue pas encore
domptée par le studio.
Savage
se plaindra donc
de
la qualité de l’enregistrement de son premier disque, trop saturé,
et préférera celui de son successeur, Hyperactive,
aux mélodies plus accrocheuses. Pourtant, c’est bien cette
électricité permanente qui en provoque toute l’excitation,
au-delà des morceaux, joyaux de Heavy-Metal parfait. Le groupe pense
alors enfin rejoindre la cour des grands, portés par des critiques
dithyrambiques tant sur cet album que sur les concerts à venir.
Savage croisera même Metallica au Festival Aardschock Festival de
1984 aux Pays-Bas. Les deux atteindront un premier firmament
électrique avant de voir leurs destinées musicales respectives se
séparer.
tous droits réservés